Vérification périodique des centrifugeuses
Rappel de la réglementation
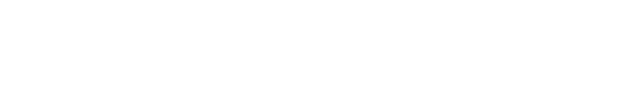
- + de 30 ans d'expérience multimarque
- + de 50 points de contrôles
- Veille permanente des recommandations fabricant
- Intégration des prestations de Métrologie
Le code du travail et les instituts nationaux encadrent et préconisent la vérification de ces équipements au travers de plusieurs décrets et arrêtés dont le plus connu est le décret 93-40 du 11 janvier 1993 qui met en place les articles du code du travail qui régulent encore aujourd’hui ces vérifications.
Nous ne nous arrêtons pas à ces vérifications, car en plus de 30 ans à travailler sur les centrifugeuses, nous avons appris à les contrôler de façon exhaustive, avec plus de 50 points de contrôle qui permettent de consigner l'état réel de vos équipements, et les risques associés, et pas seulement leur conformité à la règlementation.
Définition des matériels concernés.
• R4323-23 du code du travail (ancien L233-11) :Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.• Arrêté du 24 juin 1993 :
Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :Les centrifugeuses dont l’énergie cinétique déployée est inférieure à 1500 joules ne sont donc pas concernées. Cette énergie cinétique est d’ailleurs indiquée sur la fiche signalétique de l’appareil en utilisant les unités du S.I., à savoir le Newton mètre (Nm).
[...]
- centrifugeuses;[...]
Au travers de ces deux textes, les centrifugeuses sont clairement identifiées comme des équipements de travail concernés par les vérifications périodiques et est motivée aussi la destination de ces vérifications, la sécurité des utilisateurs. On peut aussi, afin de préciser le périmètre de cette définition, s’intéresser à la note technique de l’INRS N°9 du 2 aout 1995 qui stipule :
Centrifugeuses : L’arrêté du 5 mars 1993 n’a pas eu pour objectif d’élargir le champ des vérifications périodiques annuelles au-delà de celles qui étaient déjà demandées à l’article 14 de la circulaire du 18 janvier Il s’agit des « centrifugeuses à panier » et « essoreuses centrifuges » exclusivement destinées à extraire la partie liquide d’une charge, ou à séparer des liquides composant un mélange au moyen de la force centrifuge engendrée par la rotation du panier. Les petites centrifugeuses dont le panier a un diamètre inférieur ou égal à 400 mm ne sont pas soumises aux vérifications périodiques annuelles, si l’énergie cinétique mise en œuvre est inférieure ou égale à 1500 joules.
Définition des contrôles obligatoires
• R4323-24 (ancien L233-11 Al4) :Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspection du travail.• Arrêté du 5 mars 1993 (modifié par l'arrêté du 4 juin 1993) :
Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes.
Les vérifications générales périodiques visées aux articles 1er et 2 doivent porter sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. Ces vérifications, limitées aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots, sont les suivantes :
a) Vérification visuelle de l'état physique du matériel : Stabilité de la machine et de ses équipements (fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés) ; Fixation des éléments de protection ; Etat des matériaux (notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales) ; Etat de propreté (notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux) ; Etat des filtres et des échappements ; Etat des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques.
b) Vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de fonctionnement : Présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement Caractéristiques anormales de fonctionnement (notamment bruit, vibrations, température, chocs) ; Fonctionnement des dispositifs d'arrêt automatiques ou à actionnement volontaire ; Fonctionnement des dispositifs d'arrêt associés à une fonction de protection.
c) Vérification des réglages et des jeux : Niveau des fluides ; Pression d'air, d'huile ; Etat des ressorts (notamment dans les dispositifs de freinage et d'embrayage) ; Appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande ; Etat des pièces d'usure (notamment garnitures de freins et d'embrayage) ; Réglage des fins de course.
d) Vérification de l'état des indicateurs : Etat des appareils de mesure (notamment manomètres, thermomètres, tachymètres) ; Etat des dispositifs de signalisation (notamment voyants et inscriptions).
Qui peut faire ces contrôles ?
La note de l’INRS ED 828 précise dans son introduction qui peut effectuer les vérifications périodiques : Les vérifications techniques doivent être effectuées par un technicien possédant une connaissance approfondie de la prévention des risques dus à l’installation, connaissant bien le matériel, les techniques de construction et disposant des appareils de contrôle adéquats. Ce technicien connaîtra en outre les textes réglementaires, les recommandations et les normes applicables à cette installation.La réalisation des vérifications par l’utilisateur habituel du matériel peut être déconseillée, car il peut s’être adapté à un fonctionnement dégradé. Ce vérificateur appartiendra à l’établissement ou à une entreprise spécialisée exerçant régulièrement cette activité.
Il faut donc faire appel à une société spécialisée, connaissant bien les centrifugeuses, les normes et les recommandations. Ces recommandations sont bien souvent issues des fabricants, et concernent, par exemple, les durées de validité ou le nombre de cycles maximum d’utilisation des accessoires (rotor, nacelles…), un simple relevé d’information sur l’équipement n’est malheureusement pas toujours suffisant.
Ce texte élimine aussi d’emblée l’approche de séparation des parties prenantes, puisqu’il intègre la possibilité d’appartenance à l’établissement du contrôleur, n’établissant pas de séparation entre les parties prenantes du contrôle et l’utilisation.
Contrôles supplémentaires que nous effectuons.
La vérification de ces éléments à minima permet de s’assurer de la conformité avec les textes en vigueur, mais en plus des points précisés par l’arrêté du 5 mars 1993, il nous semble évident que la nécessité de connaître les recommandations des constructeurs impose de signaler les écarts avec ces recommandations.Certaines recommandations concernent les accessoires utilisés, et vont au-delà de l’arrêté. Les constructeurs peuvent par exemple recommander de n’utiliser des accessoires que pour 30 000 cycles afin de limiter les risques de rupture, alors que l’arrêté ne concerne que la vérification visuelle de l’état des matériaux (impacts, rayures, point d’oxydation…).
Nous vérifions aussi tous les points mettant en cause l’état général de l’équipement, au-delà des points de conformité au code du travail et de la sécurité des utilisateurs. Ces points peuvent impacter les résultats de centrifugation ou simplement le confort d’utilisation de l’équipement. Il peut s’agir par exemple de l’encrassement du condenseur, qui n’est pas concerné par l’arrêté mais provoquera à terme une usure prématurée du compresseur et une panne évitable.
Dans notre démarche, nous préférons aussi vérifier la bonne gestion du risque électrique qui est identifié dans les articles suivants :
• Article R4324-15 :
Chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire. Sont exclues de cette obligation :• Article R4324-18 :
1° Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;
2° Les machines portatives et les machines guidées à la main.
Les équipements de travail sont munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'alimentation en énergie.En se basant sur ces articles, nous indiquons donc pour chaque centrifugeuse la présence d’un arrêt d’urgence électrique accessible et indiqué, ou visible, au poste d’utilisation. En effet, les centrifugeuses ne disposent pas de dispositifs d’arrêt d’urgence manuel en toute sécurité en dehors d’un arrêt électrique, et il est donc nécessaire qu’un dispositif de coupure de l’alimentation électrique soit présent.